Les yeux dans les yeux
Interview de Claire F.
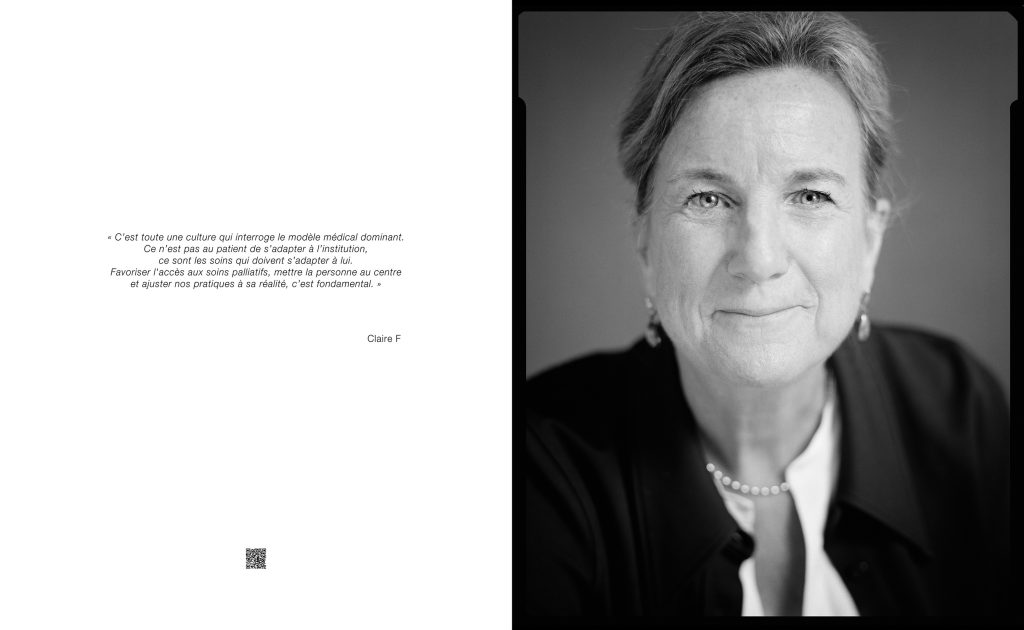
Pouvez-vous vous présenter, quel a été votre parcours de médecine et soins palliatifs ?
Je suis Claire, je suis médecin de soins palliatifs et j'ai été présidente de la SFAP pendant 5 ans.
J’ai été hospitalisée quand j’avais 6 ans, loin de mes parents. J’ai été prise en charge par l’équipe du service où j’étais, et j’ai adoré ça. Donc j’ai toujours voulu être médecin… Et puis bien plus tard, en médecine, comme externe, j’ai été très choquée dans un service de cancérologie par la façon dont les patients étaient pris en charge, complètement abandonnés par les médecins. Ensuite, je suis passée dans un service qui accueillait des patients atteints du sida. Et là, c’était l’inverse : des patients jeunes, conscients qu’ils n’allaient pas guérir, mais une relation soignants-patients très horizontale, pleine de compagnonnage. Une vraie découverte. J’ai ensuite passé deux ans au Canada pour me former aux soins palliatifs. C’est donc par le VIH que je suis arrivée là.
Le VIH a été un élément précurseur pour les soins palliatifs ?
Oui, parce qu’on devait dire la vérité aux patients, même si on était très démunis. Et ces patients étaient souvent très informés, donc cela a cassé la relation hiérarchique, paternaliste. Les médecins étaient ramenés à une juste humilité. On découvrait aussi qu’un patient qui connaît son diagnostic ne s’effondre pas forcément. Cette horizontalité m’a toujours paru essentielle.
Comment ton engagement a-t-il évolué avec le temps ?
En 2000, j’ai créé l’équipe de soins palliatifs où je travaille. Pendant longtemps, j’étais la seule médecin.
La SFAP m’a permis de rencontrer d’autres soignants qui partageaient mes questions. C’était vital pour moi, parce que le médecin en soins palliatifs le plus proche était à 100 km. Et puis, j’ai compris que chacun pouvait y trouver sa place. Petit à petit, je me suis impliquée davantage.
Pour toi, que sont les soins palliatifs aujourd’hui ?
C’est une culture du soin qui questionne le modèle dominant de la médecine. Une vraie pluridisciplinarité, une horizontalité rare dans notre système pyramidal. En soins palliatifs, on met en commun des compétences pour accompagner les patients. Ça a commencé par la fin de vie, parce que la médecine l’avait déserté, mais cette culture serait utile partout. Mettre le patient au centre, adapter les soins à lui, c’est fondamental. Et le travail en équipe permet de trouver des solutions intelligentes et ajustées. Après 25 ans, je vois que ça fonctionne.
Aujourd’hui, quels sont les grands défis pour les acteurs du soin palliatif ?
Le premier défi, c’est l’accès. La loi dit que tout le monde doit y avoir droit, mais aujourd’hui seule la moitié des personnes qui en auraient besoin y accèdent. Le deuxième défi, c’est la loi sur l’aide à mourir, qui vient heurter l’histoire même des soins palliatifs en France. Ils sont nés du refus des pratiques euthanasiques qui étaient courantes dans les années 80. Les soins palliatifs ont été une autre réponse. C’est important de le rappeler pour comprendre le débat actuel et la position des soins palliatifs dans le débat actuel
Qu’aimerais-tu que les citoyens sachent des soins palliatifs ?
Qu’il est possible d’être accompagné tout au long d’une maladie grave, pas seulement avec de la technique, mais humainement. Être atteint d’une maladie incurable, ça fait basculer une vie. Les priorités changent. Les soins palliatifs accompagnent cette vie avec la maladie, et pas seulement les derniers jours. C’est pour ça que les soins palliatifs précoces sont essentiels. Dans mon équipe, on accompagne parfois dès le diagnostic, sur plusieurs années. Cela permet d’ajuster nos soins à ce qui est vraiment important pour la personne.
Et comment concilier accompagnement, respect des volontés et solidarité collective dans les choix de fin
de vie ?
Je crois beaucoup aux discussions anticipées. Bien plus qu’aux directives écrites. Il faut des espaces de dialogue pendant toute la maladie, pour permettre aux patients de réfléchir, poser des questions, recevoir les infos nécessaires à leurs choix. Cela demande du temps, une relation de confiance. Et cette confiance, c’est au soignant de la construire. Le patient, lui, n’a pas de raison d’accorder sa confiance spontanément. C’est pourquoi la durée est indispensable. D’où l’importance de rencontrer les patients tôt. Ce qui me fait le plus mal, c’est quand un patient me dit : “Si j’avais su plus tôt que ça existait…” On a donc développé un hôpital
de jour, pour pouvoir prendre contact plus tôt, écouter ce qui se joue. Et c’est dommage que ce soit encore réservé aux derniers jours de vie.
Et si tu avais un message à transmettre à celles et ceux qui hésitent encore à parler de la fin de vie ou des
soins palliatifs ?
Je leur dirais que parler de la mort ne fait pas mourir. C’est souvent l’éléphant au milieu de la pièce.
Personne n’ose nommer les choses. Mais c’est très libérateur. En consultation, je dis souvent : “Parlez de ce qui vous inquiète.” Car souvent, on se protège mutuellement en évitant les sujets douloureux — les soignants comme les patients. Dire que la parole est libre, que cela ne nous fait pas peur, c’est déjà énorme.
Et cela permet d’aller à l’essentiel. C’est comme ça que parfois, à la fin d’une longue consultation, on se dit que là, on a vraiment touché à quelque chose d’important.
" C'est toute une culture qui interroge le modèle médical dominant.
Ce n'est pas au patient de s'adapter à l'institution, ce sont les soins qui doivent s'adapter à lui.
Favoriser l'accès aux soins palliatifs, mettre la personne au centre et ajuster nos pratiques à sa réalité, c'est fondamental. "
