Les yeux dans les yeux
Interview de Camille R.
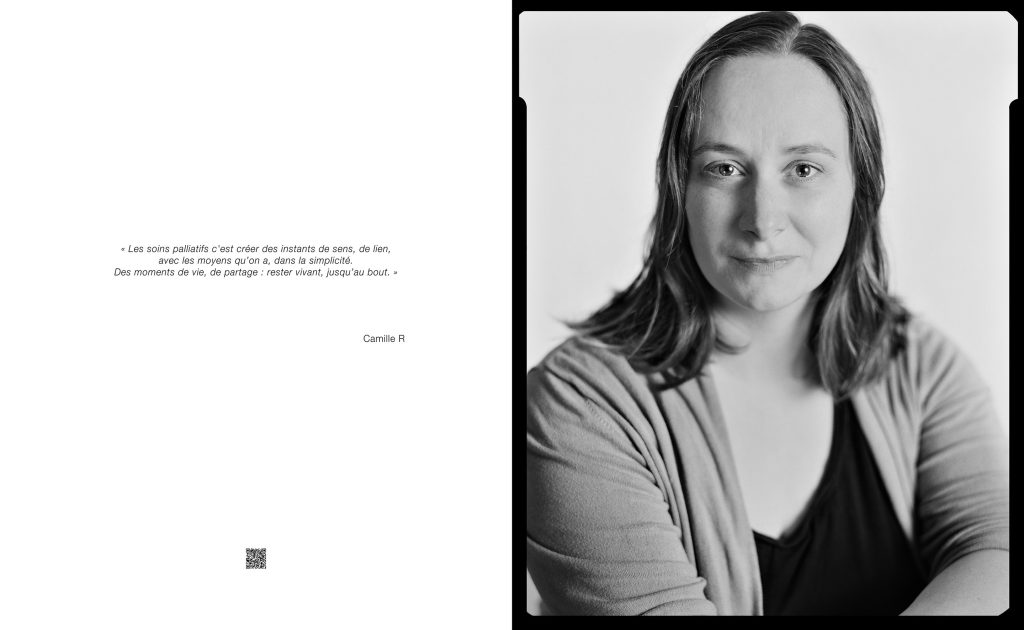
Peux-tu me parler de ton parcours et comment tu es arrivée en soins palliatifs ?
J’ai commencé par deux années de médecine. Je n’ai pas eu le concours, mais j’ai suivi des cours de bioéthique donnés par un anesthésiste reconverti en soins palliatifs. C’était passionnant. Je savais que je ne poursuivrais pas en médecine, mais ce cours m’a donné envie d’explorer les soins palliatifs.
Pendant mes études, j’ai orienté mes stages vers la médecine polyvalente et travaillé comme aide-soignante, notamment en unité de soins palliatifs et en cancérologie.
Après mon diplôme d'infirmière, j’ai obtenu un poste de nuit en médecine interne, dans un service avec quelques lits identifiés soins palliatifs. Mais les conditions étaient dures : manque de moyens, isolement, rotation rapide des patients… Je ne me sentais pas vraiment en soins palliatifs, et encore moins en équipe.
J’ai ensuite rejoint une unité de soins palliatifs, de jour cette fois. Ça a été une révélation. Un vrai travail d’équipe, une prise en charge globale des patients et de leurs proches… Ce sont des histoires très fortes qui marquent. L’intensité émotionnelle, mais aussi physique, était énorme.
Au bout de trois ans, j’ai senti que j’atteignais mes limites physiquement. Mais les soins palliatifs, ça reste ce qui me fait vibrer : ce sentiment de vraiment prendre soin, d’être utile, de considérer la personne dans sa globalité. C’est une richesse rare.
Quand une équipe mobile de soins palliatifs s’est ouverte, j’ai pu faire la transition depuis l’unité. Ce que j’aime dans l’équipe mobile, c’est qu’on ne se contente pas d’intervenir auprès des patients : on accompagne aussi les soignants. Même si les soins palliatifs ne sont pas leur spécialité, on peut les aider à évoluer, à mieux comprendre, à semer des graines qui germeront ailleurs.
Et surtout, l’équipe mobile permet de rendre les soins palliatifs plus accessibles. En unité, les places sont rares. Beaucoup de patients n’y arrivent jamais. Avec l’équipe mobile, on peut amener la qualité des soins palliatifs là où ils sont : en gériatrie, en médecine, dans des lieux non spécialisés. C’est ce qui me fait rester.
C’est chaque fois nouveau, chaque fois humainement riche, et ça a du sens.
Ce que j’aime le plus, c’est réussir à créer un espace pour la réflexion éthique dans les services. On redonne une place au travail en équipe : ce n’est plus uniquement le médecin qui pense, c’est tout le monde qui peut s’exprimer. Bien sûr, la décision finale revient au médecin, mais permettre ce temps d’échange… ça redonne du sens au travail. Les soignants retrouvent du plaisir à soigner, ils ne se sentent plus maltraitants — surtout quand les soins sont douloureux, et ils le sont souvent.
Et quand il s’agit de décisions lourdes — arrêt de traitement, limitation d’exploration — là, je ressens pleinement mon utilité. On permet une vraie pause dans le rythme effréné, on change le cours de la prise en
charge. Même en dehors de l’unité, les patients peuvent bénéficier de cette qualité d’écoute. Et ça devrait être possible partout, surtout en fin de vie.
Ce qui est beau aussi, c’est cette dynamique d’équipe qu’on voit émerger. C’est lent, ça se diffuse doucement, mais ça prend. Les soignants, les médecins, se questionnent, se laissent parfois bousculer… et nous bousculent aussi. Certains nous appellent en pensant qu’on va dire « il faut tout arrêter », mais non.
Notre rôle, c’est de remettre une réflexion globale, pas de trancher. Il y a une vraie complémentarité entre curatif et palliatif.
Comment vis-tu le rapport à la souffrance et à la mort ?
Je sais qu’il y a des situations qui me touchent plus que d’autres. Certaines restent en tête, me rendent plus vulnérable. Ce qui me permet de tenir, c’est de bien me connaître — et de connaître les collègues avec qui je travaille.
Depuis 2016, je suis exposée à la mort et à la souffrance, déjà en médecine interne avant les soins palliatifs.
Pour durer, il faut se sentir en sécurité dans l’équipe, pouvoir être soi-même. Et surtout, ne pas projeter ses propres peurs ou croyances sur le patient. Il faut lui laisser vivre ce qu’il a à vivre, lui et ses proches.
Je le dis souvent aux équipes : on pense que la mort, c’est l’affaire des unités de soins palliatifs… mais en réalité, elle est partout. Là où on n’en parle pas, c’est souvent encore plus violent. Tout va vite, on n’a pas le temps de nommer ce qui se passe. C’est là que c’est le plus dur.
En unité, on avait environ 200 décès par an, et j’étais là pour presque la moitié. L’annonce, la toilette mortuaire… parfois face à des enfants. C’était le quotidien.
Aujourd’hui, en équipe mobile, je suis moins en contact direct avec la mort. Il y a moins d’intensité physique, mais plus de conflits à accompagner. C’est un autre type de difficulté. Et ça a été un vrai changement pour moi. J’ai une mémoire très physique — le toucher, les gestes. Les plaies cancéreuses, les corps abîmés… ça marque profondément. Maintenant, je garde la richesse de la relation, de la réflexion,
sans ce poids sensoriel-là.
C’est une question que tous les soignants devraient se poser : comment je fais face à la souffrance ? à la mort qui est là, même si on ne la nomme pas ? Parce que souvent, c’est dans les services curatifs qu’elle est la plus brutale.
Quelle est la philosophie des soins palliatifs ?
C’est considérer le patient avant tout comme une personne, pas juste comme un malade. Une personne qui traverse quelque chose, et qu’on aide à vivre au mieux ce moment. Avec une qualité de soin, bien sûr — technique, mais aussi relationnelle.
On ne le laisse pas seul face aux décisions : on l’accompagne, on le guide. Mais toujours dans son intérêt, pour qu’il puisse vivre ce temps avec ses proches, sans jugement.
Une histoire ?
Je me souviens d’un de mes premiers patients en unité de soins palliatifs. Il avait un cancer de la prostate avec des métastases osseuses. Une compression médullaire non diagnostiquée à temps l’avait rendu paraplégique. Il avait trois enfants : la plus jeune avait 15 ans, un fils autiste, et une fille avec qui il n’avait plus aucun contact depuis des années.
Dans l’unité, on a vraiment pris soin de lui. Il y a eu un moment très fort : un atelier pâtisserie. Ils ont refait, en famille, un gâteau au chocolat qu’il préparait quand les enfants étaient petits. Sa femme et ses trois enfants étaient là, y compris son fils autiste — ce qui était loin d’être simple.
Lui, en fauteuil, dans la cuisine de l’unité… Ils ont cuisiné, partagé ce gâteau.
Et il est décédé quelques jours plus tard.
Je me souviendrai toujours de l’atmosphère ce jour-là. Un vrai flottement, une douceur immense. Sa femme était bouleversée. Pour moi, c’est ça, les soins palliatifs : créer ces instants de sens, de lien. Avec les moyens qu’on a, mais dans la simplicité. Des moments de vie, de partage.
C’est ça, rester vivant, jusqu’au bout.
" Les soins palliatifs c'est créer des instants de sens, de lien, avec les moyens qu'on a, dans la simplicité.
Des moments de vie, de partage : rester vivant, jusqu'au bout. "
