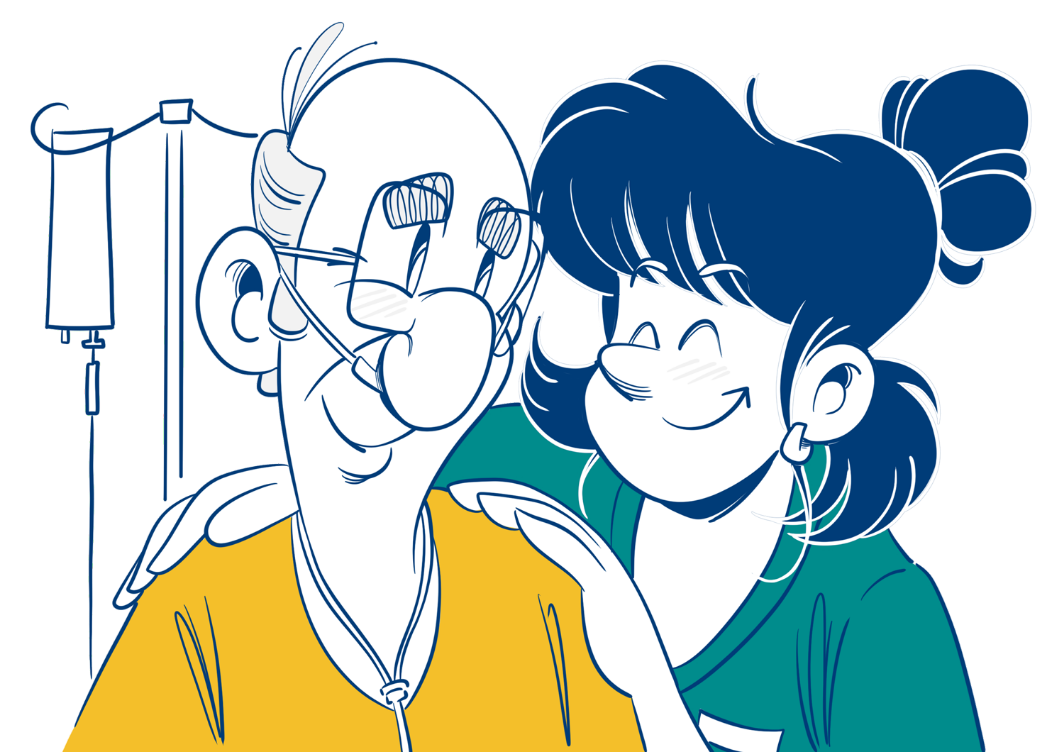Définition des soins palliatifs par la "loi de 1999"
Article 1er de la loi n°99-477
Livre préliminaire
Droits de la personne malade et des usagers du système de santé
Titre 1er : Droits de la personne malade :
Art. L.1er A. – Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
Art. L.1er B. – Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
Art. L.1er C. – La personne malade peut s’opposer à toute investigation ou thérapeutique.
********
Précision du programme national de développement des soins palliatifs en 2002
Les soins palliatifs et l’accompagnement concernent les personnes de tous âges atteintes d’une maladie grave, évolutive mettant en jeu le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Ces personnes peuvent souffrir d’un cancer, d’une maladie neurologique dégénérative, du sida ou de tout autre état pathologique lié à une insuffisance fonctionnelle décompensée (cardiaque, respiratoire, rénale) ou à une association de plusieurs maladies. Les soins prodigués visent à améliorer le confort et la qualité de vie et à soulager les symptômes : ce sont tous les traitements et soins d’accompagnement physiques, psychologiques, spirituels et sociaux envers des personnes et leur entourage.
Définition par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
Définition de 1990
Les soins palliatifs sont des soins actifs, complets, donnés aux malades dont l’affection ne répond pas au traitement curatif. La lutte contre la douleur et d’autres symptômes et la prise en considération des problèmes psychologiques, sociaux et spirituels, sont primordiales. Le but des soins palliatifs est d’obtenir la meilleure qualité de vie possible pour les malades et leur famille. De nombreux éléments des soins palliatifs sont également applicables au début de l’évolution de la maladie, en association avec un traitement anticancéreux. Les soins palliatifs affirment la vie et considèrent la mort comme un processus normal, ne hâtent ni ne retardent la mort, procurent un soulagement de la douleur et des autres symptômes pénibles, intègrent les aspects psychologiques et spirituels dans les soins aux malades, offrent un système de soutien pour aider les malades à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort, offrent un système de soutien qui aide la famille à tenir pendant la maladie du patient et leur propre deuil.
Définition de 2002
Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. Les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort, offrent un système de soutien qui aide la famille à tenir pendant la maladie du patient et leur propre deuil, utilisent une approche d’équipe pour répondre aux besoins des patients et de leurs familles en y incluant si nécessaire une assistance au deuil, peuvent améliorer la qualité de vie et influencer peut-être aussi de manière positive l’évolution de la maladie, sont applicables tôt dans le décours de la maladie, en association avec d’autres traitements pouvant prolonger la vie, comme la chimiothérapie et la radiothérapie, et incluent les investigations qui sont requises afin de mieux comprendre les complications cliniques gênantes et de manière à pouvoir les prendre en charge.
Autres définitions
Définition par le Conseil National de l’Ordre des médecins (1996)
Les soins palliatifs sont les soins et l’accompagnement qui doivent être mis en œuvre toutes les fois qu’une atteinte pathologique menace l’existence, que la mort survienne ou puisse être évitée.
Définition par l’ANAES (2002) (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé)
Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus, évolutifs, coordonnés et pratiqués par une équipe pluriprofessionnelle. Ils ont pour objectif, dans une approche globale et individualisée, de prévenir ou de soulager les symptômes physiques, dont la douleur, mais aussi les autres symptômes, d’anticiper les risques de complications et de prendre en compte les besoins psychologiques, sociaux et spirituels, dans le respect de la dignité de la personne soignée. Les soins palliatifs cherchent à éviter les investigations et les traitements déraisonnables et se refusent à provoquer intentionnellement la mort. Selon cette approche, le patient est considéré comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. Les soins palliatifs s’adressent aux personnes atteintes de maladies graves évolutives ou mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale, ainsi qu’à leur famille ou à leurs proches. Des bénévoles, formés à l’accompagnement et appartenant à des associations qui les sélectionnent peuvent compléter, avec l’accord du malade ou de ses proches, l’action des équipes soignantes.